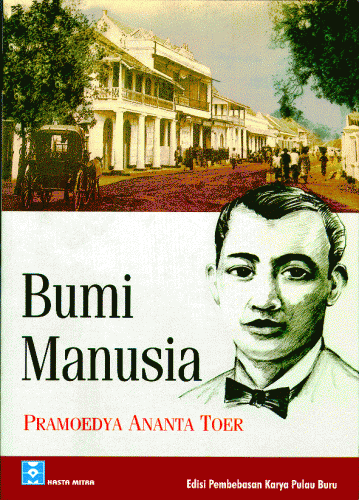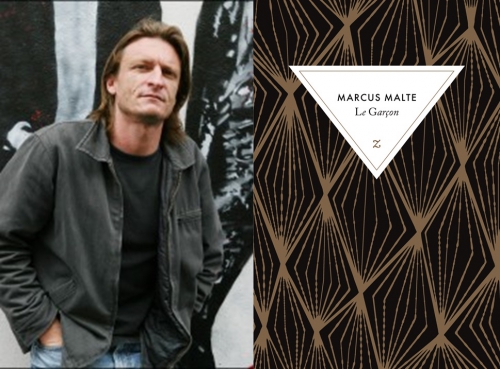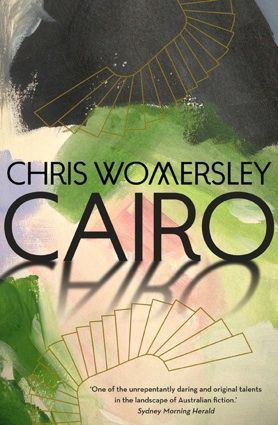J’ignorais tout de Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), appelé « Pram » en Indonésie, en ouvrant Le monde des hommes (Bumi Manusia, traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos), le premier tome de Buru Quartet : ce roman écrit en prison n’a été publié qu’après la libération en 1980 de ce « géant des lettres indonésiennes » (postface) qui a passé un quart de sa vie en captivité pour des raisons politiques.
Minke y raconte son histoire, celle d’un jeune Javanais brillant dans les études, ce qui lui vaut d’être éduqué à l’européenne à l’HBS, un « prestigieux lycée néerlandais » à Surabaya, privilège rare pour un indigène des Indes néerlandaises. Il est né le 31 août 1880, comme la reine Wilhelmine qui monte sur le trône au moment où commence son récit, en septembre 1898.
Robert Suurhof, son condisciple, citoyen néerlandais bien que ses parents soient métis (il est né sur un bateau), veut lui présenter une autre « déesse à la beauté sans pareille » : il l’emmène à Wonokromo, à la ferme Buitenzorg, où son ami Robert Mellema l’accueille dans une pièce luxueusement meublée. Sa sœur, Annelies est « une jeune fille à la peau blanche, raffinée, aux traits européens, aux cheveux et aux yeux noirs d’indigène ». Minke est subjugué.
Ce sont les enfants de Nyai Ontosoroh, la compagne du riche Herman Mellema : cette indigène qui parle un excellent néerlandais le reçoit en toute décontraction, vantant la beauté de sa fille qui ne se mêle pas suffisamment aux autres d’après elle. A table, où tout est parfait, du service de table raffiné à la disposition des couverts dont Minke observe attentivement l’emploi, la conversation va bon train. Ensuite la mère d’Ann lui fait visiter l’entreprise familiale, c’est elle qui l’administre et la fait prospérer, au grand étonnement du jeune homme.
C’est à son premier maître d’école que Minke doit son surnom : il l’avait rappelé à l’ordre en se fâchant : « Silence, espèce de monk… Minke ! » Depuis lors, tout le monde l’appelle ainsi. A côté de ses cours, le jeune homme a lancé un petit commerce de meubles précieux, une initiative qui plaît à Nyai. L’irruption du père Mellema, furieux de l’apercevoir chez lui et le traitant de « singe », tourne court avec l’intervention de sa compagne : elle renvoie à sa chambre cet homme grossier et négligé devenu « le déshonneur de ses descendants ». Après l’avoir servi loyalement pendant des années, c’est elle qui dirige la maison à présent, sans lui.
Obsédé depuis cette visite par la belle Annelies, conscient de la mauvaise réputation que lui vaudrait de fréquenter la demeure d’une nyai, ancienne esclave, non mariée, quelle que soit sa réussite, Minke va demander conseil à son ami et « compagnon d’affaires », Jean Marais, un peintre, qui a combattu plus de quatre ans dans les rangs de l’armée coloniale. Celui-ci l’incite à retourner voir ces gens pour se faire par lui-même une idée de leur valeur. Jean élève sa fille, May, dont la mère, une jeune combattante faite prisonnière, a été poignardée par son jeune frère qui s’est aussi donné la mort.
Quand il reçoit une lettre de Nyai, le pressant de revenir auprès d’Annelies qui dépérit de ne plus le voir, Minke se décide à retourner à la ferme où il est même invité à s’installer – il habite une pension de famille. Fait-il une sottise ? Vaudrait-il mieux qu’il aille à B., chez ses parents ? L’attirance est trop forte. Ann raconte à Minke le bouleversement survenu chez eux quand son père, sans qu’elle sache pourquoi, est « devenu un étranger dans sa propre maison » où il n’apparaît plus que rarement. Sa mère, vendue à quatorze ans au « grand administrateur » Mellema, a tout appris de lui, si bien qu’il se reposait de plus en plus sur sa concubine et partageait les bénéfices avec elle. Quand il s’est éloigné, Nyai a dû se débrouiller seule. Robert, le frère d’An, ne s’intéresse à rien, à part le football, la chasse et l’équitation. Nyai est si insistante que Minke accepte de loger à la ferme et de profiter des services qui lui sont offerts.
A travers l’histoire des Mellema, de Jean Marais et de Minke, dont on finira par connaître les parents – son père, promu « bupati » de B., est choqué par le refus de son fils d’entrer dans le jeu servile des Indiens en échange de titres –, Pramoedya Ananta Toer raconte l’histoire, les mœurs et les conflits sociaux d’une société profondément inégale. Un précurseur de la presse en malais, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, a inspiré le personnage de Minke qui tient à son indépendance d’esprit, écrit et publie des nouvelles, se débat avec ses sentiments envers Annelies si fragile et sa mère si forte, qu’il ne peut laisser tomber.
Le Monde des hommes, à la fois romanesque et politique, relate une prise de conscience et un apprentissage, sur près de cinq cents pages qui constituent le premier volet de Buru Quartet. Buru, c’est le nom de l’île sur laquelle Pramoedya Ananta Toer l’a écrit, envoyé au bagne de 1965 à 1979 sous la dictature de Suharto, après avoir été emprisonné par le gouvernement colonial néerlandais de 1947 à 1949. Auteur de plus de cinquante romans, nouvelles et essais, cet humaniste est un grand témoin de l’évolution sociale dans son pays.